Ce titre peut être une poudrière : les femmes et les études supérieures, des termes à connotation psychologique souvent mal utilisés… et pourtant : tentons de parler de ce véritable problème sans tomber dans des clichés qui ne mèneraient nulle part : en trois parties, comme il se doit.
Le syndrome de l’imposteur
Cette expression est apparue à la fin des années 1970 à la suite d’une étude américaine[1] et se répand chaque jour davantage depuis le développement des thématiques du bien-être au travail. Au départ, le syndrome de l’imposteur désigne le fait pour un individu de douter, quasi-maladivement, de ses accomplissements personnels, n’y voyant toujours qu’une conjonction de facteurs, qui exclut ses compétences propres. Par exemple : « j’ai eu de la chance » ou « untel m’a aidé ».
Ce phénomène est en soi assez banal et provient d’un mécanisme appelé « ignorance pluraliste » : au sein d’un groupe d’individus, chacun réfute une norme en privé, mais s’imaginant que les autres s’y conforment, fait le choix de suivre cette norme. Dans notre cas, chacun doute de soi, mais le doute de soi n’étant que peu valorisé par la société, chacun prétend ne pas douter.
Là où le doute sur une capacité à réussir (doute qui atteindra 70% des personnes au moins une fois au cours de leur vie) acquiert son caractère de « syndrome » ou de « complexe », c’est lorsqu’il devient systématique au point que la personne s’imagine que sa réussite n’est pas uniquement factice, elle est aussi duperie, mensonge : presque une escroquerie.
[1] Clance, P.R., & Imes, S.A. (1978). The Impostor Phenomenon in High Achieving Women: Dynamics and Therapeutic Interventions. Psychotherapy : Theory Research and Practice, 15, 241‑247
Des thèses médicales montrent de plus des corrélations importantes entre l’anxiété et le syndrome de l’imposteur[1] (selon l’échelle CIPS – Clance Impostor Phenomenon Scale). Cela n’est que peu étonnant puisque la peur d’être démasqué́ constitue un élément d’anxiété́ fondamental de ce syndrome (Kolligian, 1990), et que la peur de l’évaluation et du jugement d’autrui en sont deux points importants (Clance & O’Toole, 1987). Une des conséquences de ce syndrome est ainsi la mise en place d’un certain nombre de stratégies pour se sentir moins coupable de cette imposture, ou pour la masquer aux yeux du monde.
[1] Kevin Chassangre. La modestie pathologique : pour une meilleure compréhension du syndrome de l’imposteur. Psychologie. Université Toulouse le Mirail – Toulouse II, 2016.

Le syndrome de l’imposteur et la classe prépa
Reprenons cette étude ayant permis de découvrir le syndrome de l’imposteur : elle portait justement sur des individus qui, malgré de bonnes notes, ne pensaient pas mériter leur place à l’université. Amusant ?
Les lycéens sujets à ce syndrome mettent des stratégies en place qui sont de deux types, les deux conduisant généralement à rejeter en bloc l’idée de rejoindre une classe prépa.
Les « je n’en fous pas une »
La première stratégie est celle (et vous pardonnerez les anglicismes) de l’underdoing, soit d’en faire moins que ce dont on est capable, sciemment, pour éviter de se confronter à l’échec.
Trois possibilités ici : la première est celle du franc refus d’obstacle, de se tenir à l’écart de tout challenge, de toute ambition importante par crainte de l’échec. Dans ce cas précis, ce n’est pas l’échec en soi qui est effrayant mais davantage son caractère public – si autrui voit mon échec au concours, alors tous sauront que je ne vaux rien. Seconde option : procrastiner, remettre les choses au lendemain ou travailler en dilettante de sorte que, dans l’hypothèse où l’échec se produirait, il serait un échec « par choix », ayant du moins l’avantage de ne pas révéler le manque de compétences puisqu’il est de façon visible à attribuer à un manque de travail. Troisième et dernière option : le petit génie qui n’a jamais travaillé. Que cette dernière catégorie ne se voie pas aller en prépa peut paraître surprenant, et pourtant, le caractère inné de leurs compétences jusqu’en Terminale leur donne l’impression – biaisée – que devoir fournir des efforts est le symptôme du fait qu’ils ne sont « pas assez bons », donc, des imposteurs.
Dans tous les cas : enfer et damnation, fuyons la prépa.
Sauf que… si vous pouvez échouer, vous pouvez aussi – grâce à votre travail – réussir et quitter la classe prépa, doté d’un précieux sésame : une fois dans votre vie où vous aurez réussi seuls, de façon anonyme et impartiale puisque lors d’un concours. Comme un talisman pour toutes les prochaines fois où le doute envers vos capacités vous assaillira.


Les « je ne vais pas tenir le choc »
La seconde stratégie est celle de l’overdoing, soit d’en faire trop pour que la réussite, que l’on se refuse toujours à attribuer à ses qualités, soit alors fruit d’une énorme quantité de travail, qui vient justifier aux yeux de l’individu qu’il n’est alors plus un imposteur.
Cette stratégie conduit alors (toujours dans le cas de l’orientation vers une classe prépa) aux écueils suivants :


- perfectionnisme à l’extrême qui conduit le lycéen excellent à être déjà « sous l’eau » en Terminale, et à se refuser une prépa dont il ne voit pas comment il pourrait se sortir ;
- experts en tout qui auront peur de lever la main en cours pour dire « je ne sais pas » ;
- « surhommes » qui ont besoin non seulement de faire aussi bien, mais même mieux que tous les autres, et dans tous les domaines, afin de se sentir ne serait-ce qu’au début de leurs ambitions ; et
- solitaires autodidactes qui se sentent obligés de réussir seuls et qui, dans le cas où ils devraient demander de l’aide, auraient le sentiment de voir, là aussi, l’imposture révélée.
Sauf que… la prépa est alors apprentissage d’une meilleure gestion des priorités, d’une capacité à faire appel à autrui quand cela est nécessaire, d’une capacité à admettre que parfois, « fait est mieux que parfait » ou « Done is better than perfect », pour paraphraser Sheryl Sandberg. Peut-être un peu douloureux sur le coup, mais ça peut vous éviter un burn-out à 35 ans.
Quelle que soit la catégorie à laquelle appartient notre lycéen qui doute de ses capacités, il est factuel que la classe préparatoire est une confrontation à ce syndrome de l’imposteur. En effet, le concours a deux dimensions effrayantes : il classe les étudiants, les compare en quelque sorte, les met face à leurs doutes ; il se fait sur la base exclusive des compétences acquises par un travail intensif, corrigeant les biais tant des dilettantes (qui ne s’en sortiront pas sans travailler) que des sur-performants (qui ne pourront en faire le double). Une mise en exergue des peurs, mais une formidable opportunité de corriger des biais de perception de soi à un âge où l’on se construit encore, à un âge où l’on peut prendre des risques, à un âge où il est bien trop tôt pour avoir peur.
D’autant plus que le syndrome de l’imposteur n’est pas un problème de confiance en soi, mais un problème de perception de soi qui génère un problème de confiance en soi.
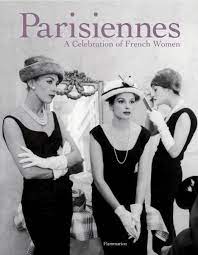
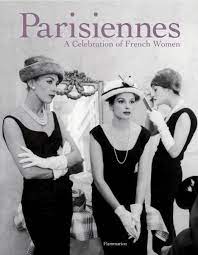
Le syndrome de l’imposteur, la classe prépa et les femmes
Nous venons à la dimension genrée de notre article : notre même étude initiale portait exclusivement sur des femmes – preuve que l’inadéquation entre un succès professionnel et la perception des capacités, si elle n’est pas l’apanage de la gent féminine, se remarque davantage chez celle-ci. Ultérieurement, il a été observé que l’appartenance plus générale à un groupe « minoritaire » renforçait la propension à souffrir d’un syndrome de l’imposteur.
Il est souvent dit que les femmes, pour accepter le même poste qu’un homme, ont besoin de savoir qu’elles ont x% des compétences pour ce poste, ce x% étant évidemment très supérieur aux y% qui font qu’un homme accepterait le dit poste. On en déduit un peu rapidement que les femmes ont moins confiance en elles que les hommes. La confiance en soi est énergie, capacité de travail mise au service de la réalisation de ses objectifs. La perception de soi est l’auto-évaluation de ses qualités, de son potentiel et partant, de son destin « mérité ».
Les lycéennes n’ont pas de problème de confiance en elles en lien avec leurs notes : ce qui diffère entre les hommes et les femmes, c’est l’interprétation, en termes de perception de soi, de l’adéquation de ses compétences à des critères prédéfinis. Pour parler plus simplement, ce que perçoit le lycéen de son « niveau » n’est pas ce que perçoit la lycéenne de son « niveau », et ce, quand bien même ils auraient la même note !
D’une bonne voire excellente note, le lycéen en conclut généralement qu’il est bon (66% disant être plus intelligents que le reste de la classe[1]), donc qu’il a « le niveau » pour continuer, la note étant après tout venue sanctionner l’adéquation aux critères. De la même note, les lycéennes sont moins nombreuses à y voir la preuve qu’elles sont « plus intelligentes » (54%) : importance moindre donnée à l’évaluation (la note) quant à sa capacité à dire la vérité sur la valeur (le niveau).
Biais supplémentaire chez les lycéennes envisageant une classe prépa mais doutant de leur valeur ! Biais qui est d’ailleurs à l’origine de la désaffection des mathématiques chez les lycéennes depuis le début de la réforme du bac (42% de moins en 2022 qu’en 2020) : elles n’avaient pas forcément de moins bonnes notes en maths, mais à notes égales, elles ne se sentaient pas « le niveau de continuer ».
[1] Who perceives they are smarter? Exploring the influence of student characteristics on student academic self-concept in physiology, Katelyn M. Cooper, Anna Krieg, and Sara E. Brownell, Advances in Physiology Education 2018 42:2, 200-208
Une fois ce constat dressé : soit que des lycéens (et, beaucoup, des lycéennes !), souvent intelligents, curieux, avides d’apprendre, ont une perception faussée de leur valeur les poussant à ne pas se sentir le courage d’aller en prépa, que fait-on ?


On leur rappelle que… le concours n’est finalement qu’une évaluation, qui certes arrive à la sortie de deux ans de préparation, mais qui n’est jamais qu’une série de critères (d’épreuves) – et non le moment où se joue la valeur d’un individu !
Il est ainsi bien plus sensé que de demander à des professeurs expérimentés – donc qui connaissent l’adéquation potentielle entre des notes de Terminale et une capacité à réussir au concours – si l’on a ce fameux « niveau » pour réussir en prépa, plutôt que de tirer cette affirmation, quasi péremptoire, de biais psychologiques qui ne méritent pas que l’on y sacrifie réussite et ambition.


